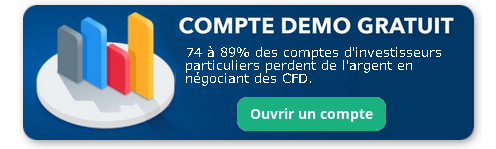Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions: Récentes | Sans réponse
#1 26-09-2025 12:58:05
- Climax
- Administrateur

- Inscription: 30-08-2008
- Messages: 6 411


Le marché du travail vs le marché boursier

Le marché du travail et le marché boursier sont liés, et nous allons examiner les implications fondamentales de cette relation, ainsi que les raisons pour lesquelles elle est importante.
Points clés à retenir :
➡️ Un marché du travail tendu agit comme un « contre-indicateur » pour les rendements boursiers futurs.
➡️ Un faible taux de chômage indique que les décideurs politiques pourraient bientôt resserrer la politique monétaire afin de freiner l'inflation, ce qui crée un environnement plus risqué pour les actions.
➡️ À l'inverse, un taux de chômage élevé précède souvent une période favorable pour les actifs, les décideurs politiques mettant en œuvre des mesures de relance.
➡️ Les coûts de main-d'œuvre, qui représentent une dépense importante pour les entreprises, constituent un mécanisme de transmission clé entre le marché du travail et les bénéfices des entreprises et, par conséquent, les cours boursiers.
➡️ En cas d'écart de production négatif dans l'économie (c'est-à-dire un marché du travail faible), la banque centrale a tendance à dépasser les prix globaux des actifs (au-delà de leurs niveaux d'équilibre compatibles avec la production potentielle actuelle).
➡️ Ce dépassement entraîne un décalage temporaire entre la performance des marchés financiers et l'économie réelle, mais accélère la reprise.
Aperçu général
Lorsque le marché du travail est très atone, c'est-à-dire lorsque le taux de chômage est élevé, les décideurs politiques sont fortement incités à stimuler l'économie en abaissant les taux d'intérêt et en prenant d'autres mesures d'assouplissement monétaire et budgétaire, si nécessaire.
Cela se traduit généralement par une période favorable pour les prix des actifs.
Même si l'économie reste faible à la fin d'une récession et au début d'une expansion, le marché boursier renoue généralement avec une tendance haussière. L'économie financière précède l'économie réelle.
Une fois que l'on arrive à la fin du cycle et que le marché du travail est peu tendu, les décideurs politiques commencent à ralentir les choses, car ils craignent l'inflation et l'instabilité financière (par exemple, les bulles spéculatives, la création excessive de crédit).
Ils commencent alors à supprimer les mesures de soutien. Ainsi, alors que l'économie réelle a tendance à être favorable pendant cette période, celle-ci devient plus difficile pour les actions.
Finalement, ils vont trop loin dans le resserrement de la politique monétaire, car il est difficile de trouver le bon équilibre. Il en résulte une baisse du marché boursier, suivie d'une baisse de l'économie réelle.
Cette tendance s'inverse ensuite lorsque les taux d'intérêt sont réduits et/ou que d'autres mesures d'assouplissement monétaire et budgétaire sont mises en place pour corriger le déséquilibre.
Pour cette raison, on peut dire que la santé du marché du travail est un contre-indicateur du moment le plus propice pour acheter des actions.
Lorsque le taux de chômage est élevé, on peut généralement être assez optimiste quant à l'évolution future des actions, à condition que les décideurs politiques soient compétents et aient le pouvoir de prendre les mesures nécessaires pour soutenir l'économie.
À l'inverse, lorsque le taux de chômage est faible, il est prudent d'être plus circonspect à l'égard des actions, car les décideurs politiques commencent à retirer leur soutien.
Représentation graphique : marché du travail vs actions
Si l'on examine les cycles économiques précédents aux États-Unis (qui ont tendance à être coordonnés avec ceux d'autres pays), chaque fois que le taux de chômage U-3 descend à environ 4 %, les rendements prévisionnels des actions ont été relativement faibles.
Chacune des lignes roses marque approximativement le point où le taux de chômage U-3 est descendu à environ 4 %. C'est à ce moment-là que les décideurs politiques commencent à s'inquiéter de plus en plus de l'inflation.

Marché du travail vs marché boursier
Le marché du travail
Le marché du travail suit le cycle économique, ce qui en fait un facteur clé pour les traders et les investisseurs qui cherchent à prendre des mesures tactiques.
À long terme, la productivité est le principal facteur qui stimule la croissance économique et les fluctuations des prix des actifs.
C'est le processus par lequel nous apprenons davantage, faisons davantage et inventons davantage. Au fil du temps, les acquis et les informations sont plus nombreux que les pertes, de sorte que la productivité augmente généralement avec le temps et n'est pas aussi volatile que les cycles du crédit et de la monnaie.
Toutefois, à court terme, les cycles sont plus importants.
La chute archétypale des actions
Lorsque le marché du travail se resserre au point de générer une pression excessive sur les prix dans une économie, les banquiers centraux réagissent généralement en augmentant les taux d'intérêt, en réduisant progressivement leurs achats d'actifs et en recourant à d'autres moyens d'assouplir la politique monétaire.
Finalement, ils vont trop loin en raison de la difficulté à gérer les compromis entre production et inflation en fin de cycle, ce qui entraîne une baisse du crédit.
Au début de cette crise du crédit ou de liquidité, on observe généralement les baisses les plus marquées des prix des actifs.
Cela surprend beaucoup de gens, qui pensent que l'économie est forte et ne comprennent pas pourquoi cela se produit. (« Le marché est irrationnel. »)
Au cours de cette phase, l'argent qui parvient aux débiteurs via leurs revenus et leurs nouveaux emprunts n'est pas suffisant pour rembourser leurs créanciers.
Les actifs doivent être vendus pour honorer ces obligations. En conséquence, les dépenses sont réduites afin de rester liquide.
Les gens finissent par perdre leur emploi en raison de la baisse de l'activité économique. Les revenus globaux diminuent pendant cette période. Cela entraîne une baisse des dépenses, dans un cercle vicieux.
Parfois, les investisseurs interprètent à tort la baisse initiale des prix des actifs comme une opportunité d'achat. En effet, ils partent du principe que les prix ont baissé alors que les bénéfices restent corrects, ce qui confère aux actifs une meilleure valeur.
Mais les prix des actifs baissent parce que certains se rendent compte que les bénéfices des entreprises sont sur le point de chuter.
Lorsque les prix des actifs baissent, cela réduit la valeur des garanties et des nouveaux emprunts. Moins d'emprunts signifie moins de dépenses. Les dépenses d'une personne constituent les revenus d'une autre, ce qui entraîne une baisse des revenus.
Ainsi, le problème posé par la baisse des prix des actifs ne concerne pas seulement la richesse. Par « richesse », on entend que les actifs financiers sont des promesses de paiement futur.
Mais il y a aussi un effet négatif sur les revenus.
La solvabilité des emprunteurs est mesurée en fonction :
la valeur nette et les ratios de crédit (valeur des actifs, revenus et garanties par rapport à leurs dettes) et
le montant de leurs revenus par rapport au montant de leurs obligations au titre du service de la dette.
Lorsque la valeur nette et les revenus des emprunteurs diminuent plus rapidement que leurs dettes, leur solvabilité diminue.
Par conséquent, les prêteurs sont moins enclins à prêter.
Cela déclenche une réaction en chaîne qui conduit à une baisse des emprunts -> une baisse des revenus -> une baisse des dépenses -> une baisse des prix des actifs -> une baisse de la valeur des garanties -> une baisse de la solvabilité, et ainsi de suite, dans un cercle vicieux qui s'autoalimente.
De nombreux emprunteurs finissent par être totalement exclus des marchés du crédit.
En effet, les entités qui peuvent normalement se permettre de prêter subissent des pertes sur leurs actifs et les perspectives économiques sont très incertaines en période de pertes importantes et de forte volatilité sur les marchés financiers.
Les nouveaux prêts se tarissent et les capitaux ne sont plus disponibles.
Cela vaut souvent même pour les entreprises gérées de manière prudente sur le plan financier et pour les projets dont les rendements futurs attendus sont élevés.
Comme les prix des actifs à risque, cela entraîne une augmentation des rendements ajustés au risque.
Les banquiers centraux et autres décideurs politiques réagissent pour remédier à la situation lorsque les conditions deviennent intolérables.
Sur les marchés développés actuels, les taux d'intérêt sont très bas. Cela pose donc un dilemme quant à la manière d'assouplir la politique monétaire en l'absence de flexibilité pour réduire les taux.
Lorsque les taux d'intérêt nominaux ne peuvent pas être abaissés davantage parce qu'ils sont déjà à zéro ou légèrement négatifs, c'est là que le gouvernement intervient en tant que prêteur de dernier recours et doit rassurer les investisseurs en leur garantissant qu'il viendra à la rescousse et sauvera le système.
Le gouvernement, à condition qu'il dispose d'une monnaie de réserve et qu'il ait effectivement le pouvoir de le faire, garantira que des montants importants d'argent et de crédit seront mis à la disposition de diverses entités de l'économie afin qu'elles puissent compter sur une reprise rapide.
Cependant, ce soutien des décideurs politiques n'est généralement pas promis assez rapidement. Cela signifie qu'il y a généralement des pertes douloureuses avant que ce soutien ne soit fourni.
Dans la plupart des crises financières, il existe également généralement des blocages et du ressentiment à l'égard de certains acteurs qui ont contribué à la crise. Les contribuables ne veulent pas que leur argent soit utilisé pour les soutenir et les décideurs politiques veulent qu'ils supportent les conséquences de leurs choix.
Néanmoins, lorsqu'il devient évident que le coût de l'absence de soutien est supérieur à celui de la fourniture d'un soutien, les responsables publics interviennent inévitablement pour faire ce qu'ils peuvent afin de soutenir l'ensemble.
Les acteurs du marché peuvent alors commencer à voir le bout du tunnel et à espérer une reprise des marchés financiers, des activités de prêt et de l'économie dans son ensemble.
À ce stade, les marchés du travail sont généralement faibles, voire très faibles. Mais ils s'améliorent dès lors qu'un soutien politique suffisant est apporté.
La vitesse à laquelle ils se redressent dépend de l'ampleur des mesures de relance mises en place et du rythme de la reprise globale des marchés du crédit et des capitaux.
Dynamique du marché du travail
La pénurie de main-d'œuvre peut accélérer la croissance économique en entraînant une hausse des salaires, la création de nouvelles entreprises et le développement de nouveaux produits. À terme, elle peut également contribuer à augmenter l'offre de main-d'œuvre, car davantage de travailleurs rejoignent le marché du travail grâce à des incitations accrues à l'entrepreneuriat et à la reconversion professionnelle.
Si ce processus est suffisamment rapide, il peut atténuer les effets négatifs de la pénurie de main-d'œuvre sur les tendances de l'emploi.
Toutefois, si cela prend trop de temps ou est trop lent, les travailleurs pourraient se retrouver sous-qualifiés pour les emplois qu'ils souhaitent occuper, car leurs compétences antérieures ne sont pas adaptées à leurs nouvelles fonctions, à moins qu'ils ne suivent une reconversion professionnelle.
Ceux qui connaissent le chômage ou le sous-emploi pendant cette période peuvent subir des conséquences négatives, telles que la perte de compétences ou le changement de secteur d'activité, qui auront également une incidence sur leur capacité future à gagner leur vie.
Les exemples sont nombreux. Par exemple, dans le domaine du journalisme, qui se numérise de plus en plus, un nombre croissant de travailleurs de l'imprimerie et de la distribution devront être recyclés, car leurs compétences sont moins valorisées.
Le marché du travail sera confronté à des problèmes de compétences et de disponibilité de la main-d'œuvre.
La pénurie de main-d'œuvre qui a suivi la récession de 2008 en est un exemple. Le taux de chômage aux États-Unis a atteint environ 10 % en octobre 2009. La même année, les offres d'emploi sur les sites d'emploi en ligne ont augmenté d'environ 40 %, les entreprises se sentant à nouveau à l'aise pour embaucher.
Les employeurs ont commencé à rechercher des candidats plus expérimentés et plus qualifiés pour les postes disponibles. Beaucoup d'entre eux ont élargi leur vivier de talents grâce à des stratégies de recrutement telles que des programmes de recommandation par les employés ou une présence accrue sur les réseaux sociaux où les candidats potentiels représentaient une grande partie de l'audience (par exemple, LinkedIn).
En outre, certaines entreprises ont externalisé une partie de leur main-d'œuvre et ont gagné en flexibilité grâce aux évolutions technologiques, telles que le recrutement à distance de travailleurs numériques et la popularité croissante des plateformes de freelance pour les emplois techniques.
À mesure que la pénurie de main-d'œuvre s'accentuait, les coûts de main-d'œuvre (c'est-à-dire les salaires) ont commencé à augmenter, les employeurs se disputant une main-d'œuvre limitée.
De nombreux demandeurs d'emploi se sont ainsi retrouvés avec des options et un pouvoir de négociation plus importants qu'avant la récession.
Lorsque la main-d'œuvre est rare
Lorsque la main-d'œuvre est rare, les coûts salariaux augmentent et les entreprises sont incitées à investir dans des technologies permettant d'économiser de la main-d'œuvre, telles que des équipements et des logiciels capables de traiter davantage de tâches.
Cela permet de réduire les coûts salariaux, mais nécessite un délai plus long.
Pour réduire les délais, les entreprises peuvent externaliser la main-d'œuvre vers des plateformes ou des freelances, ce qui leur permet de réduire leurs coûts sans avoir à se soucier de l'efficacité ou de l'efficience des technologies.
Ainsi, même si la pénurie de main-d'œuvre entraîne une augmentation des coûts, les entreprises peuvent s'adapter grâce à des investissements technologiques ou en embauchant/fidélisant des employés plus qualifiés qui nécessitent moins d'heures et de dépenses pour la formation et le maintien en poste (c'est-à-dire l'éducation/la formation).
Et à mesure que le marché du travail se resserre, il devient plus difficile pour les employeurs de répondre aux demandes des clients, car ils ne disposent pas d'un nombre suffisant d'employés pour couvrir les heures nécessaires. L'incapacité à répondre à la demande conduit les entreprises à restructurer ou à reformater leur modèle commercial par le biais de l'automatisation, de l'augmentation des heures supplémentaires, de la restructuration des responsabilités professionnelles et du recrutement d'employés capables de couvrir plusieurs rôles à la fois (par exemple, les développeurs full-stack).
En raison de la nature cyclique des pénuries et des pénuries de main-d'œuvre, ces travailleurs peuvent s'attendre à voir leurs salaires augmenter lorsqu'ils trouvent un emploi et auront tendance à avoir moins de pouvoir de négociation lorsque le marché du travail est très détendu.
Impact de la main-d'œuvre sur les marges
Ces dynamiques liées à la main-d'œuvre sont importantes non seulement pour la politique monétaire, mais aussi pour les bénéfices des entreprises et les marchés boursiers.
Les coûts de main-d'œuvre représentent une part importante des bilans des entreprises, soit environ 55 % des dépenses des sociétés du S&P 500.
Ils sont généralement trois à quatre fois supérieurs aux autres postes.
Étant donné que les coûts de main-d'œuvre peuvent être volatils et contribuer de manière significative aux marges d'exploitation, à la qualité des flux de trésorerie des entreprises et, par conséquent, aux rendements boursiers, il est important de prêter attention à la dynamique du marché du travail et à son incidence sur les bénéfices des entreprises et le cours des actions.
Pour les entreprises, les coûts de main-d'œuvre varient d'environ +/−1 % par an en fonction du cycle économique et de l'évolution spécifique à chaque entreprise. En période de boom économique, il y a une pression pour augmenter les salaires, mais aussi pour améliorer la productivité du travail. En période de récession, les budgets salariaux sont généralement réduits, mais les revenus le sont aussi.
La main-d'œuvre est donc un enjeu majeur pour les entreprises, en particulier celles qui sont cycliques, et peut être un outil important pour évaluer la santé des entreprises et les performances boursières.
Part du travail
La part du travail est un concept qui désigne la répartition des revenus dans une économie entre les travailleurs et les actionnaires, c'est-à-dire le pourcentage du chiffre d'affaires total qui revient au travail (c'est-à-dire les salaires/rémunérations).
Si la part du travail diminue, les bénéfices augmentent car les coûts de main-d'œuvre diminuent.
L'inverse est également vrai. Si la part du travail augmente, les coûts de main-d'œuvre augmentent.
Une diminution de la part du travail signifie généralement que les coûts de main-d'œuvre diminuent en pourcentage des dépenses des entreprises, ce qui signifie que la pénurie de main-d'œuvre augmente, que les marchés du travail se resserrent, que les entreprises deviennent plus efficaces avec leurs travailleurs ou que l'automatisation rend la main-d'œuvre moins coûteuse grâce à la réingénierie des processus ou à la technologie, tandis que les revenus restent stables ou augmentent.
En outre, la part du travail est en baisse depuis le début des années 2000. Cela est significatif car la pénurie de main-d'œuvre devrait augmenter les coûts de main-d'œuvre, ce qui signifie que la part du travail devrait remonter, mais ce n'est pas le cas en raison de divers facteurs tels que l'externalisation à l'étranger et le remplacement de la main-d'œuvre par la technologie.
Si la part du travail revenait à ses moyennes historiques (si le travail continuait sur la même voie), cela signifierait que les prix de la main-d'œuvre seraient sous pression, que les marchés du travail se resserreraient encore davantage en raison d'une concurrence accrue pour les employés (c'est-à-dire des guerres d'enchères si les entreprises veulent ces travailleurs), les marges des entreprises diminueraient plus tard dans le cycle économique, lorsque les coûts de main-d'œuvre commenceraient à représenter une part plus importante des dépenses opérationnelles totales des entreprises, et les cours des actions pourraient subir une pression à la baisse ou afficher des rendements modérés en raison de l'augmentation des coûts de main-d'œuvre.
Dans l'ensemble, la plupart des statistiques montrent que la part du travail diminue, que les marchés du travail se resserrent, que les coûts de main-d'œuvre augmentent, que les prix de la main-d'œuvre sont sous pression (en raison de la pénurie de main-d'œuvre) et que la main-d'œuvre représente une part de plus en plus importante des dépenses opérationnelles des entreprises.
C'est pourquoi il est de plus en plus important de tenir compte de la dynamique du travail lors d'investissements ou de transactions liés au cycle économique : les coûts de main-d'œuvre, la pénurie de main-d'œuvre, le resserrement/l'efficacité du marché du travail et la part du travail fournissent tous des informations importantes sur le caractère cyclique des marchés du travail et sur l'évolution de la contribution du travail aux dépenses d'exploitation des entreprises au fil du temps.
Impacts distributifs
Dans ce contexte, les traders et les investisseurs devront surveiller la croissance des salaires et les indicateurs d'inflation.
Ils devront également envisager d'équilibrer leurs choix tactiques en matière de sélection d'actions entre les entreprises à forte intensité capitalistique et celles à forte intensité de main-d'œuvre.
Les entreprises à forte intensité de main-d'œuvre comprennent des secteurs tels que les soins de santé et les biens de consommation courante. Les entreprises à forte intensité de capital comprennent les services financiers.
Conclusion
La dynamique du marché du travail influe directement sur les bénéfices des entreprises et les marchés boursiers par le biais de la contribution des coûts de main-d'œuvre au chiffre d'affaires et aux marges globaux.
Il est donc important que les investisseurs comprennent comment ceux-ci peuvent fluctuer d'un cycle économique à l'autre, selon que les entreprises embauchent ou licencient massivement.
La pénurie de main-d'œuvre aura un impact sur l'inflation, les coûts de main-d'œuvre, la disponibilité de la main-d'œuvre, les mouvements de main-d'œuvre (réaffectation de la main-d'œuvre), la structure du marché du travail (entrepreneuriat et économie collaborative par opposition aux entreprises traditionnelles), la performance des marchés boursiers, les tendances en matière de croissance des salaires, la politique monétaire, et entraînera des changements structurels à long terme pour l'emploi.
La pénurie de main-d'œuvre peut exercer une pression sur les prix de la main-d'œuvre, qui se reflète dans les salaires. Lorsque la main-d'œuvre est rare, les travailleurs ont un meilleur pouvoir de négociation, ce qui se traduit par des salaires plus élevés. Ces conditions pourraient entraîner une augmentation des coûts de main-d'œuvre pour les employeurs et une baisse des rendements boursiers pour ceux qui ne parviennent pas à s'adapter de manière adéquate.
La pénurie de main-d'œuvre peut être une bonne nouvelle pour les travailleurs jusqu'à ce que les entreprises mettent en œuvre davantage d'automatisation et de numérisation dans leurs modèles commerciaux en raison d'une main-d'œuvre traditionnelle insuffisante.
L'impact sur les rendements boursiers dépendra de la rapidité avec laquelle les entreprises s'adapteront à ces pressions tout en tirant parti de l'intelligence artificielle disponible ou d'autres moyens de numériser leurs modèles commerciaux avant que ces méthodes ne deviennent elles-mêmes obsolètes en raison des progrès technologiques et de la concurrence d'autres acteurs.
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.
Hors ligne
- Utilisateurs enregistrés en ligne dans ce sujet: 0, invités: 1
- [Bot] ClaudeBot