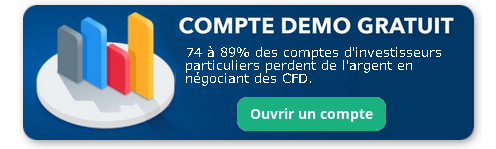Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions: Récentes | Sans réponse
#1 11-07-2024 12:43:13
- Climax
- Administrateur

- Inscription: 30-08-2008
- Messages: 6 411


Fonds spéculatifs vs gestion d'actifs : quelle est la différence ?

Les fonds spéculatifs et les sociétés de gestion d'actifs traditionnelles fonctionnent selon des modèles commerciaux radicalement différents, bien qu'ils aient tous deux pour mission de gérer l'argent d'autrui.
Ils peuvent sembler similaires en apparence, mais leurs approches de la génération de profits et de la croissance de leurs activités sont presque diamétralement opposées.
Cet article explore ces différences et explique pourquoi les fonds spéculatifs restent souvent relativement petits alors que les gestionnaires d'actifs traditionnels visent une croissance substantielle.
Points clés à retenir :
➡️ Les fonds spéculatifs visent à optimiser les performances, tandis que les gestionnaires d'actifs visent à accroître les actifs.
➡️C'est pourquoi les fonds spéculatifs plafonnent leur taille à un certain niveau, tandis que les gestionnaires d'actifs passifs cherchent à croître presque perpétuellement.
➡️Les day traders et autres traders tactiques peuvent s'inspirer de ces différences pour équilibrer leurs stratégies.
Par exemple, ils peuvent utiliser des approches indicielles pour une partie de leur portefeuille afin de bénéficier de la croissance de l'ensemble du marché sans contraintes de capacité.
Pour leurs stratégies de trading actif, ils doivent être attentifs aux coûts de transaction et reconnaître que certaines stratégies peuvent avoir une évolutivité limitée, devenant potentiellement moins efficaces au fur et à mesure que la taille des transactions augmente.
➡️La banque privée, la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs et les fonds spéculatifs forment un écosystème financier intégré - où les banquiers privés gèrent les relations, les gestionnaires de patrimoine conçoivent des stratégies, les gestionnaires d'actifs fournissent des véhicules d'investissement et les fonds spéculatifs offrent des rendements spécialisés.
Cela permet d'offrir des solutions personnalisées et complètes aux clients très fortunés en fonction de leur complexité, de leur taille et de leurs besoins globaux.
Le modèle traditionnel de gestion des actifs : Croissance des actifs
Les sociétés de gestion d'actifs traditionnelles, telles que les sociétés de fonds communs de placement, suivent généralement un modèle commercial simple : elles facturent des frais fixes basés sur les actifs sous gestion.
Cette structure de frais incite fortement à faire croître les actifs sous gestion autant que possible, car ils sont directement liés aux revenus de la société.
Exemple
Par exemple, un fonds traditionnel peut facturer 60 points de base (0,60 %) sur les actifs sous gestion.
Avec un milliard de dollars sous gestion, il génère 6 millions de dollars de revenus annuels.
Pour augmenter ses bénéfices, l'entreprise doit attirer davantage d'actifs, soit par des efforts de marketing, soit en réalisant de bonnes performances qui attirent de nouveaux investisseurs.
Ce modèle bénéficie d'économies d'échelle.
À mesure que les actifs sous gestion augmentent, le coût de gestion de chaque dollar supplémentaire diminue (en supposant que la stratégie soit passive ou presque passive), ce qui permet d'accroître les marges bénéficiaires.
En outre, de nombreuses stratégies traditionnelles, telles que les fonds indiciels ou les fonds d'actions à grande capitalisation, ont une capacité pratiquement illimitée, ce qui permet aux entreprises de gérer des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars.
Quelques sociétés (par exemple, Vanguard, Blackrock) gèrent des milliers de milliards de dollars.
En bref, elles se concentrent sur les rendements bêta basés sur le marché.
Le modèle des fonds spéculatifs : Performance
Les fonds spéculatifs, quant à eux, fonctionnent selon un paradigme fondamentalement différent.
Leur structure de frais se compose généralement de deux éléments :
une commission de gestion (souvent 2 % des actifs sous gestion) et
une commission de performance (généralement 20 % des bénéfices)
Cette structure permet d'aligner plus étroitement les intérêts du fonds sur ceux de ses investisseurs, puisqu'une part importante des revenus du fonds est directement liée à la performance.
Contrairement aux gestionnaires d'actifs traditionnels, les fonds spéculatifs qui réussissent sont souvent confrontés à des contraintes de capacité.
L'alpha est un jeu à somme nulle. Il est difficile d'obtenir de l'alpha avec de petites sommes d'argent et devient encore plus difficile avec de grandes sommes d'argent.
Leurs stratégies peuvent s'appuyer sur des inefficacités du marché ou des opportunités spécifiques qui deviennent moins rentables au fur et à mesure que le capital est déployé.
Par conséquent, les fonds spéculatifs ont souvent une taille optimale au-delà de laquelle les rendements peuvent diminuer.
Exemple
Prenons l'exemple d'un fonds spéculatif capable de générer 100 millions de dollars de bénéfices par an.
Avec 500 millions de dollars d'actifs sous gestion, cela représente un rendement de 20 %.
Le fonds gagnerait 10 millions de dollars en frais de gestion (2 % de 500 millions de dollars) et 20 millions de dollars en commissions de performance (20 % de 100 millions de dollars), soit un total de 30 millions de dollars de revenus.
Après soustraction des coûts d'exploitation, les gestionnaires du fonds pourraient dégager un bénéfice substantiel, à condition de les maîtriser.
L'augmentation des actifs sous gestion ne profite pas nécessairement aux gestionnaires de fonds spéculatifs. S'ils doublaient leurs actifs sous gestion pour atteindre 1 milliard de dollars sans augmenter leurs bénéfices totaux, leur rendement chuterait à 10 %.
Alors que les frais de gestion augmenteraient, les frais de performance pourraient diminuer s'il y a des considérations de taux de rendement minimal (par exemple, les investisseurs obtiennent les premiers 6 % de rendement annuel gratuitement, ou ils obtiennent les rendements de l'indice gratuitement) ou s'il y a des coûts d'exploitation plus élevés pour gérer plus d'argent (par exemple, plus d'embauches pour les relations avec les investisseurs), ce qui pourrait entraîner une baisse des revenus globaux pour les gestionnaires.
Cette dynamique crée une structure d'incitation intéressante dans laquelle les gestionnaires de fonds spéculatifs cherchent souvent à optimiser leurs actifs sous gestion plutôt qu'à les maximiser.
Certains fonds très performants retournent même du capital aux investisseurs ou s'abstiennent de nouveaux investissements afin de maintenir leur capacité à générer des rendements élevés.
Combiner les deux modèles
Certaines entreprises combinent efficacement les deux modèles.
AQR et Bridgewater Associates, par exemple, appliquent des stratégies traditionnelles de fonds spéculatifs, mais gèrent également un volume substantiel d'actifs dans des stratégies plus traditionnelles et moins onéreuses.
Cette double approche leur permet de bénéficier des rendements élevés et des commissions de performance de leurs opérations de fonds spéculatifs, tout en générant des revenus réguliers à partir d'un plus grand nombre d'actifs gérés de manière traditionnelle.
Implications
Il est important de comprendre ces différents modèles d'entreprise pour les investisseurs qui cherchent à savoir où allouer leur capital.
Il est également important pour les traders, les investisseurs et les personnes chargées de l'allocation des capitaux de savoir exactement quel type de modèle d'entreprise ou d'approche ils souhaitent utiliser.
Les sociétés de gestion d'actifs traditionnelles offrent une large exposition au marché et des frais généralement moins élevés, ce qui les rend adaptées aux stratégies d'investissement passives à long terme.
Leur taille peut leur apporter stabilité et liquidité, mais peut limiter leur capacité à surperformer le marché de manière significative.
À l'inverse, les fonds spéculatifs offrent un potentiel de rendement plus élevé et des stratégies idéalement décorrélées des mouvements généraux du marché.
Néanmoins, ils s'accompagnent de frais plus élevés et exigent souvent des investissements minimums substantiels assortis de périodes de blocage.
L'importance qu'ils accordent à la performance peut conduire à des rendements élevés dans les bonnes années, mais comporte également le risque de pertes importantes.
Comment les fonds spéculatifs et la gestion d'actifs s'intègrent-ils à la gestion de patrimoine et à la banque privée ?
La gestion de patrimoine et la banque privée sont souvent confondues avec les fonds spéculatifs et les sociétés de gestion d'actifs.
Ils opèrent tous au sein du même écosystème financier, mais jouent des rôles différents.
Quand ils sont bien intégrés, ils offrent aux particuliers très fortunés (UHNWI), aux familles et aux institutions une approche transparente et multidimensionnelle de la gestion et de la croissance du capital.
Voici comment elles fonctionnent ensemble.
La banque privée au cœur de la relation
La banque privée est la porte d'entrée des clients fortunés dans le monde des services financiers au sens large.
Elle est fortement axée sur les relations et offre des services financiers personnalisés tels que des solutions de crédit sur mesure, la gestion des dépôts, la structuration des successions, les services fiduciaires et l'attention d'un concierge.
Le banquier privé est généralement le principal point de contact du client et assure la coordination entre les équipes internes et les partenaires externes.
Il ne gère pas directement les investissements, mais sert de passerelle vers des capacités plus approfondies, notamment la gestion de patrimoine, la gestion d'actifs et l'accès à des investissements alternatifs tels que les fonds spéculatifs.
Lorsqu'elle est bien exécutée, la banque privée n'est pas seulement une question de service, mais aussi d'orchestration.
Les différents niveaux de la banque privée
Dans le segment des clients très fortunés, il existe des niveaux informels que les banques privées utilisent pour structurer leurs modèles de services internes.
Ces niveaux ne sont pas annoncés publiquement, mais ils déterminent la manière dont les ressources sont allouées en coulisses.
Par exemple,
Un client disposant de 30 à 100 millions de dollars peut être classé dans la catégorie « core UHNW ».
Un client disposant de 100 à 250 millions de dollars peut être qualifié de « UHNW stratégique ».
Ceux qui possèdent 250 millions de dollars ou plus sont souvent traités comme des « clients clés ».
Ces classifications aident les banques à déterminer le niveau d'attention, d'expertise et de personnalisation dont bénéficie chaque client.
Par exemple, un client de 40 millions de dollars peut travailler principalement avec un seul gestionnaire de relations qui coordonne les équipes.
Un client de 250 millions de dollars, en revanche, se verra souvent attribuer une équipe complète comprenant un conseiller en investissement, un spécialiste de la structuration du crédit, un stratège fiscal et un responsable de la planification philanthropique.
L'étendue des services s'élargit en fonction de la complexité et des opportunités de revenus.
Lorsque les clients atteignent le niveau du centimillionnaire - 100 millions de dollars et plus - l'approche change de manière significative.
À ce stade, les clients sont souvent retirés du flux de travail standard de la banque privée et pris en charge par des groupes d'élite tels que l'équipe de clients stratégiques ou un bureau de conseil sur mesure qui fait le lien entre la banque privée et la banque d'investissement.
Ces équipes sont formées pour répondre à des besoins plus complexes, tels que la monétisation d'actifs illiquides, la structuration d'entités transfrontalières ou la préparation d'entreprises à la vente.
L'offre devient hybride : à la fois family office de haut niveau et conseil institutionnel.
Banque privée par zone géographique
La géographie ajoute un autre facteur de différenciation.
Aux États-Unis, les clients fortunés sont souvent des entrepreneurs du secteur de la technologie, des cadres de la finance ou de l'entreprise, ou des promoteurs immobiliers qui détiennent des positions concentrées et des liquidités importantes.
En Amérique latine ou au Moyen-Orient, le patrimoine est généralement détenu par de grandes entreprises familiales et les clients considèrent souvent les banques privées comme des dépositaires offshore et des partenaires de diversification globale.
En Europe, de nombreuses personnes fortunées ont hérité d'un patrimoine et se concentrent davantage sur la préservation du capital et la succession.
C'est en Asie que la diversité est la plus grande : les créateurs de richesse de la première génération, les empires familiaux de longue date et les clients mobiles à l'échelle mondiale se côtoient sur le même marché, ce qui rend la segmentation et les modèles de service plus complexes.
Dans toutes les régions, les seuils de richesse varient, mais le principe sous-jacent est le même : le service s'intensifie avec l'échelle, la sophistication et l'opportunité stratégique.
La gestion de patrimoine en tant que couche stratégique
La gestion de patrimoine intervient pour concevoir la stratégie financière globale.
Elle comprend :
l'allocation d'actifs
l'efficacité fiscale
la modélisation des flux de trésorerie
l'établissement du profil de risque
la planification de la succession, et
le transfert de patrimoine multigénérationnel
Il s'agit d'interpréter la vie financière du client dans un cadre d'investissement et de succession à angles multiples.
Les gestionnaires de patrimoine constituent souvent des portefeuilles en faisant appel à des gestionnaires tiers et à des solutions internes.
Ils supervisent le déploiement des capitaux sur les marchés publics et privés.
Les gestionnaires de patrimoine les plus sophistiqués agissent comme des CIO (Chief Investment Officer) externalisés, veillant à ce que le portefeuille du client corresponde à ses objectifs à long terme, à sa tolérance au risque et à ses besoins de liquidités.
Lorsque des family offices sont impliqués, les gestionnaires de patrimoine peuvent agir en coordination avec des conseillers juridiques, fiscaux et philanthropiques.
La gestion d'actifs comme moteur
Les gestionnaires d'actifs fournissent les instruments d'investissement qui alimentent les portefeuilles des clients.
Ces sociétés gèrent des fonds communs de placement, des ETF, des SMA (Separately Managed Accounts) et des mandats institutionnels portant sur des actions, des titres à revenu fixe et des stratégies multi-actifs.
Les gestionnaires de patrimoine et les banques privées allouent souvent des capitaux à ces produits, qui sont sélectionnés en fonction de leur adéquation, de leur profil risque/rendement, de leurs frais et de leur historique.
La relation est réciproque : les gestionnaires d'actifs dépendent de la distribution par les canaux de la banque privée et de la gestion de patrimoine, tandis que les banques privées s'appuient sur les gestionnaires d'actifs pour la mise en œuvre.
Les grandes institutions peuvent même avoir des branches de gestion d'actifs intégrées verticalement, c'est-à-dire qu'elles proposent des fonds propres ou des solutions en marque blanche qui sont vendues en interne.
Les fonds spéculatifs à la recherche d'alpha
Les fonds spéculatifs, comme nous l'avons vu, s'inscrivent dans un cadre plus large en tant que véhicules d'exposition non corrélée ou à haut risque et à haut rendement.
Ils sont souvent accessibles via la plateforme de gestion alternative de la banque privée ou via un modèle de conseil patrimonial à architecture ouverte.
Les clients sophistiqués peuvent allouer des fonds spéculatifs à des stratégies telles que les actions long/short, les stratégies macro, les stratégies événementielles, l'arbitrage de crédit, entre autres.
Pour les clients qui remplissent les conditions requises (généralement des acheteurs accrédités ou qualifiés), les fonds spéculatifs sont examinés par le comité d'investissement de la banque ou de la société de conseil.
Le contrôle préalable, l'évaluation des risques et la sélection des gestionnaires sont centralisés, ce qui permet de disposer d'une gamme de fonds bien définie.
Certaines banques privées gèrent également des plateformes de fonds de hedge funds (« fonds de fonds ») afin d'offrir une diversification au sein de la pochette de produits alternatifs.
Chaîne de valeur intégrée
Ensemble, ces couches forment une chaîne de valeur intégrée. Le banquier privé gère la relation et identifie les besoins.
Le gestionnaire de patrimoine élabore la stratégie et répartit les fonds sur les marchés financiers.
Le gestionnaire d'actifs met en œuvre la majeure partie de l'exposition. Enfin, les fonds spéculatifs offrent des rendements différenciés dans des tranches spécialisées du portefeuille.
Au plus haut niveau, ces fonctions se confondent.
Les institutions disposant de capacités internes (par exemple, JPMorgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, UBS) fournissent tous les services en interne, tandis que d'autres construisent des modèles d'architecture ouverte.
L'intégration consiste à aligner les produits, la stratégie et les services sur le client, et non sur les silos internes.
Lorsqu'elle est bien réalisée, il s'agit d'une solution patrimoniale complète.
Conclusion
Si les fonds spéculatifs et les gestionnaires d'actifs traditionnels s'efforcent tous deux de faire fructifier le patrimoine des investisseurs, leurs approches pour atteindre cet objectif et structurer leurs activités diffèrent sensiblement.
Les gestionnaires traditionnels cherchent à accumuler des actifs en bénéficiant d'économies d'échelle, tandis que les fonds spéculatifs privilégient souvent la performance, quitte à limiter leur taille.
Le trading de CFD implique un risque de perte significatif, il ne convient donc pas à tous les investisseurs. 74 à 89% des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent en négociant des CFD.
Hors ligne
- Utilisateurs enregistrés en ligne dans ce sujet: 0, invités: 1
- [Bot] ClaudeBot